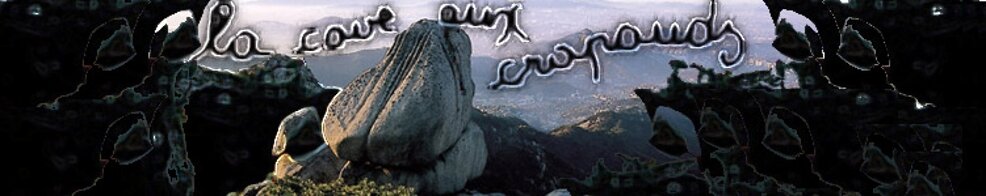Alors que s’apprête à sortir Amer, prétentieux et rébarbatif collage-hommage au giallo, (re)découvrir L’Etrange vice de Mrs Wardh et Toutes les couleurs du vice remet en lumière toute la vraie singularité d’un genre populaire, formaliste s’il en est, mais qui n’oubliait jamais d’être léger et divertissant. Plus encore il est temps de rendre justice à un Sergio Martino trop hâtivement relégué au rang de faiseur ou d’honnête artisan. Pour les quarantenaires, le cinéma de Martino renvoie immédiatement à notre imaginaire enfantin, stimulé lors de nos voyages dans le métro par les affiches du Continent des Hommes poissons et sa Barbara Bach assaillie par des monstres amphibies caoutchouteux et son menaçant « interdit aux moins de 13 ans ». Que se cachait derrière cette terreur aquatique ? Dix ans plus tard, adolescents lorsque la 6 le diffusait régulièrement en deuxième partie de soirée, on le snobait comme nanar potentiel avant de se délecter à l’âge de raison d’un beau film naïf et feuilletonnesque digne d’un Jules Verne ou Maurice Renard. Peut-être en revanche aurait-on du se contenter de la splendide affiche de Crimes au cimetière étrusque ?


Ces deux mains brandissant un couteau vers une innocente victime et cette ombre aux yeux phosphorescents titillèrent longuement notre regard émerveillé dans les présentations Scherzo vidéo et les Vidéo 7, et ne laissaient en rien présager la déception du fantasme brisé après s’être procuré une vieille vhs dans un cash converter. A l’instar d’un Umberto Lenzi, la carrière de Martino s’est en effet un peu échouée dans les années 80 dans la jungle des sous produits et des téléfilms. Mais résumer le cinéaste à cette période sans tenir compte du flamboiement des années 70 serait aussi mensonger que de définir Jess Franco comme le réalisateur des Prédateurs de la nuit. Curieux cheminement d’ailleurs que celui de Martino dont l’apogée se situe à ses débuts, soit entre 1970 et 1973, avec des œuvres aussi belles que Toutes les couleurs, le splendide poème vénéneux, Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave (Votre vice est une porte cachée dont moi seul ai la clé) (1972) ou encore le grandiose I corpi presentano tracce di violenza carnale (Torso) (1973). L’Etrange vice de Mrs Wardh appartient à ces années fastes qui verront se succéder des œuvres morbides, sensuelles, ironiques dans lesquelles s’incarne le mieux le « style » Martino, un univers sublimé en l’espace de quelques films par la présence lumineuse d’une Edwige Fenech, charnelle et fragile. Compagne de l’époque du producteur et frère du cinéaste, Luciano Martino, elle n’en reste pas moins la muse, l’égérie de Sergio au point que Mrs Wardh et Toutes les couleurs… se muent en ode à son corps et à son visage. Dès les premières minutes le cinéaste la déshabille, la mettant sous la douche, avec ou sans chemise de nuit, ou parcourant sa peau blanche parcelle par parcelle ; il succombe moins aux conventions érotiques du cinéma d’exploitation qu’à sa fascination quasi hypnotique pour l’actrice, fascination communicative pour le spectateur et qui 40 ans plus tard suscite le même trouble.


A l’exception d’une Queue du scorpion assez conventionnelle, Martino aborde toujours le giallo en feignant d’en adopter les codes pour mieux s’en échapper, et ce dès L’Etrange Vice de Mrs Wardh intégralement conçu autour de l’induction en erreur. La première tient justement dans l’idée de faire mine d’appartenir au genre dont il reprend d’abord les motifs visuels : un meurtre au rasoir dans une voiture en ouverture, des gans de cuirs, une atmosphère d’inquiétante étrangeté, de formidables instants d’angoisses solitaires dans des lieux qui se referment comme des pièges, dont le plus beau demeure une agression à la tombée de la nuit dans un parc qui s’apprête à fermer… Son synopsis paraît tout aussi archétypique : en séjour à Vienne Julie, une riche bourgeoise, se retrouve confrontée aux fantômes douloureux du passé, à ses anciens amours et péchés enfouis, vite harcelée jusqu’aux confins de la folie alors qu’un meurtrier au rasoir sévit dans la ville. De mystérieux bouquets de fleurs accompagnés de lettres anonymes, des présences inquiétantes, des soupirants trop suspects, trop curieux ou trop angéliques, avec son héroïne naïve aspirée dans les complots et les coups de théâtre à la chaine L’Etrange vice de Mrs Wardh tient plus encore d’Agatha Christie ou des mystères policiers des premiers Lenzi et des krimis dont il s’inspirait. Martino et son fidèle collaborateur Gastaldi s’en donnent à cœur joie en rendant hommage à la mécanique hitchcockienne, s’amusant à tisser la toile et emmêler les fils avec une ironie salvatrice. Ils mystifient l’héroïne comme le spectateur et le baladent de fausse piste en fausse piste, ne cessent de désamorcer, de détromper, de faire retomber le soufflet à un endroit pour le remonter à un autre, de tuer le suspense alors que la tension est à son comble pour révéler, relancer l’intrigue sur un autre pitch inattendu. Mais quel est cet étrange vice qui donne son titre à un film qui s’ouvre sur une sentencieuse citation de Freud pour mieux s’immerger dans la psyché féminine de son héroïne ? Les relations sado masochistes d’antan de Julie avec son ex-amant Jean ? Sa naïveté, l’appel de la sexualité ou tout simplement l’incapacité à dire non à chaque homme qui tente de la séduire ? Un peu de tout cela… Le plus grand trompe l’œil de Martino consiste à inciter à une première lecture misogyne poussée par la personnalité d’une héroïne dont chacun profite et dont la candeur pourrait s’apparenter à de la bêtise pour s’acheminer finalement vers une ode à la féminité, doublée d’une charge anti machiste et ce, sans jamais quitter un ton jovial et léger. Car à l’arrivée, le plus grand vice de Mrs Wardh n’est-il pas celui d’être une femme conditionnée par son milieu, tiraillée entre l’inhibition du désir et l’aspiration à se libérer, dans une société judéo-chrétienne à domination masculine ? Identifiées au péché, ses attirances naturelles et sa sensualité sont source d’une culpabilisation d’autant plus forte qu’elle ne parvient jamais à y résister. Julie s’est mariée pour fuir ses pulsions.



Elle aime ingénument le sexe et les hommes mais ne s’assume jamais en tant que femme avec son droit au plaisir et son penchant naturel à étancher sa soif. Certes, on ne peut rester aveugle à l’incroyable aura érotique du personnage, grandissant au fur et à mesure d’infortunes qui s’enchainent et lui confèrent une dimension de plus en plus fétichiste. Telle une nouvelle Justine, elle tombe d’épreuve en épreuve, de charybde en scylla. Mais cette victimisation qui fait d’elle un objet de fantasme ou de convoitise fait office de catalyseur de l’abjection des hommes dont elle est le jouet. Le charme inouï de cet Etrange vice de Mrs Wardh tient à la façon dont l’intrigue feuilletonnesque, pour ne pas dire de roman photo, nourrit la charge sociale et la satire, sans l’air d’y toucher. Edwige Fenech n’a peut-être jamais été aussi convaincante, apportant un maximum de trouble érotique à son personnage - entre naïveté affirmée et perversité soupçonnée - sur lequel semble se calquer parfaitement les mélodies sensuelles de Nora Orlandi.


De Vienne, passons à Londres … Avec Toutes les couleurs du vice Sergio Martino passe à la vitesse supérieure, en offrant un joyau aussi divertissant qu’inventif dans sa mise en scène. Toujours propice à de belles libertés stylistiques, le film se partage entre une recherche de l’épuré, traduction du temps arrêté dans l’angoisse, et l’attente et une propension à se lâcher soudainement dans le délire cauchemardesque ou bouffon. Toutes les couleurs du monde est d’autant plus passionnant qu’il est paradoxal, se situant quelque part entre l’élégance et le trivial, comme en témoignent deux parties qui s’opposent, l’une instaurant une atmosphère pesante, adoptant un rythme enveloppant, l’autre se déchainant, se libérant à grands renforts de zooms dans une frénésie qui ne lésine pas sur le mauvais goût, entre ironie et malaise. Cette dualité formelle se révèle dès l’enchainement de ses deux premières séquences. L’envoutant plan fixe du générique installe la caméra devant le jour qui baisse sur un étang, les bruits de la nature se mêlant à la musique dissonante de Bruno Nicolaï, moment poétique suspendu mêlé à une tension latente.
Lui succède alors une hallucinante séquence onirique, scène traumatique récurrente qui servira de leitmotiv et qui n’est pas sans rappeler l’univers de Una lucertola con la pelle di donna de Lucio Fulci. Ce rêve psychédélique et dérangeant dans un décor à la Dali à base de femme enceinte échevelée et de vieille femme édentée habillé en poupée surprend dans son esthétique radicale et sa brusque plongée dans l’univers de l’aliénation.
Il serait stérile de comparer les ambitions du cinéma d’exploitation avec celles d’un auteur obsessionnel, cérébral et intellectualisé comme Polanski, mais si Toutes les couleurs du vice ne peut se réclamer de la grâce d’un Rosemary’s Baby, les emprunts sautent aux yeux, au point de soupçonner d’abord une simple récupération opportuniste de ce dernier, passé à la moulinette du bis italien. Pourtant, à y regarder de plus près, il s’agit moins de piller son modèle que de jouer avec ses thèmes (tout en profitant de son succès), de parsemer le film de savoureux clins d’œil, incitant par ces détails communs, par ce déjà vu à la vigilance, la méfiance du spectateur qui connaît déjà le sujet … pour mieux l’induire en erreur. Ici, l’héroïne a déjà perdu un bébé dans un accident de voiture aux circonstances mystérieuses. On retrouve le mari ambigu, le bon docteur et ses théories sensées inspirer la confiance, la scène de la messe noire où la femme se réveille chez elle dans les bras de son époux et ce climat entre rêve et réalité qui faisait dire à Mia Farrow « this is not reality, this is really happening ». Martino emprunte à Polanski jusqu’aux plongées au dessus d’un immeuble, son appartement claustrophobe et la petite ritournelle vocale de Bruno Nicolai renvoie immanquablement à la berceuse de Komeda.
Toutes les couleurs du vice, c’est un peu Rosemary’s Baby revu à l’orée du trip LSD et de l’affaire Charles Manson. Il use du grotesque et sa mise en scène du satanisme, contrairement au Polanski, implique une désacralisation du processus de croyance. Ici, pas d’antéchrist menaçant pour l’an 1 à l’horizon, juste une secte d’adeptes de Satan habillés en hippie avec des ongles longs. En démythifiant ainsi le Mal, la vision de Martino préfigure celle des sorciers ridicules de La Neuvième Porte ou des groupies gothiques à l’image d’une époque sans magie dans La Terza Madre d’Argento. Loin du diable tout puissant, le satanisme démasque tout au plus une bandes de dangereux illuminés qui poursuivent l’héroïne au risque de la rendre folle. Martino s’amuse et démêle le complot démoniaque avec un procédé qui n’est pas sans rappeler celui du roman noir féminin à la Ann Radcliffe qui laissait présager des pires fantômes pour aboutir à la révélation d’une pure mécanique de complot. Et justement ! le cinéaste tente le spectateur, ne cessant de lui offrir des foules de pistes d’interprétation qui mettraient en jeu les vertiges de l’âme humaine ou le surnaturel infernal. Il propose à cet effet l’approche psychanalytique, nouveau mirage et nouvelle preuve d’une indéfectible distance ironique. Et pourtant le mari nous avait bien prévenu avec un très solennel « laisse la psychanalyse en dehors de tout ça », mais nous ne voulions pas le croire !


Ça n’empêche cependant pas le cinéma de Martino de baigner dans l’atmosphère d’entre deux, le fantastique, plus encore quand le monde de l’héroïne se dérobe sous ses pieds et qu’elle perd prise avec le réel. « C’est comme si je tombais dans un puits » avoue Jane. Fidèle au schéma de l’héroïne piégée, traquée, elle est une femme à la dérive, à l’identité fragmentée en plusieurs morceaux, comme en témoigne ce très beau plan de l’héroïne le regard perdu dans ses trois reflets dans trois miroirs différents, errant sans parvenir à choisir l’un d’entre eux.
Si Toutes les couleurs du vice n’obéit pas aux codes scénaristiques du giallo, il en possède en revanche toutes les caractéristiques visuelles. Aidé par la musique très inspirée de Bruno Nicolaï, Martino multiplie alors les effets anxiogènes dans lequel le quotidien distillant une menace constante enfonce un peu plus Jane dans la peur : attente d’un métro, une cage d’ascenseur, errance dans un parc jonché de feuilles mortes, solitude d’un appartement… La confusion mentale brouille la perception de la réalité, faisant glisser Toutes les couleurs dans le suspense schizophrène. La caméra de Martino est toujours mobile et l’indispensable format scope traduit à merveille l’écrasement de l’espace sur son personnage. Tout autant en extérieur qu’entre quatre murs, que Jane soit suivie dans des endroits déserts ou traquée dans un appartement dont les couleurs sont devenues brusquement rougeoyantes, chaque espace suscite la peur de l’agression et se déréalise, envahi par le bizarre. L’angoisse grandissante modifie, déforme l’espace, confondant la sensation du confiné et celle du vertige de l’infini dans des lieux devenus démesurément grands et claustrophobes.
Toute la puissance du cinéma de Martino réside dans sa parfaite fusion d’une savoureuse ironie qui fait sa griffe et d’une étrangeté sur le fil du réel. Sans jamais oublier un seul instant qu’il opère dans le divertissement, Martino décline des codes, les détourne, procède à des variations à partir d’un genre et expérimente à partir de formes imposées. Quelques années plus tard il poussera la démarche plus loin, la radicalisera, avec Votre vice est une porte cachée dont moi seul ai la clé, peut-être la plus intrigante, la plus personnelle et la plus fascinante de ses œuvres.


L’Etrange vice de Mrs Wardh (Italie, 1971) de Sergio Martino, avec Edwige Fenech, Georges Hilton, Ivan Rassimov, Alberto de Mendoza
Toutes les couleurs du vice (Italie, 1972) de Sergio Martino, avec Edwige Fenech, Georges Hilton, Ivan Rassimov, Susan Scott
Dvds édités par Néo publishing