Les racines du Mal

1969 est une année phare pour Hideo Gosha qui réalise coup sur coup deux chefs d’œuvre : Goyokin et ce chambara crépusculaire et paroxystique qu’est Hitokiri. Inséparables et antithétiques, ils forment une dilogie singulière par la sublime oxymore qu’ils constituent. Goyokin et Hitokiri s’opposent comme ombre et lumière, quand Hitokiri se présente comme un puissant miroir en négatif de son prédécesseur.
A l’héroïsme baroque de Goyokin fait écho la barbarie pure d’Hitokiri. Le déluge de pluie annonciateur de la fin d’une époque, sinon des temps, y remplace la neige majestueuse pour s’y mêler au sang, mais au lieu de le faire disparaître, il lui permet d’éclore et de se propager, en flaques, en nuages, ou en filets emportés par le courant.
La séquence de générique donne le ton : c’est un Japon de supplices, de douleurs et de mort que met en scène Gosha. Hitokiri une œuvre qui vide le jidaï-geki de toute dimension de divertissement ou d’héroïsme : le coup de sabre y fait mal et la lame entaille, déchire ou transperce profondément et longuement les chairs. Loin de la complaisance, cette représentation vise à contraindre le spectateur à affronter la réalité, sans la lui dissimuler derrière les figures stéréotypées et l’esthétique d’un ballet guerrier : nulle souffrance du carnage, nulle torture de l’agonie qui ne lui soient épargnées. Ainsi, les affrontements à l’arme blanche suscite dans Hitokiri une irrépressible épouvante.

Lors de la période troublée qui ébranle le pays de la fin de l’ère Tokugawa, le combat sans merci que se livrent une partie du Shogunat et le parti impérial oppose des deux côtés les clans traditionnels, sans que ces derniers soupçonnent qu’il leur sera fatal : loin des objectifs politiques qui vont présider à la métamorphose du Japon et à la disparition de la féodalité, ils ne soucient que d’accroître et d’asseoir chacun leur pouvoir au dépens des autres. Cette lutte à mort tient à la fois du jeu de massacre et du jeu de go, avec force éliminations, vendettas, retournements et trahisons réelles ou supposées. Mais les règles qui mettent aux prises les élites perdent toute apparence de raffinement dès que ces derniers font appel à ceux qui leur sont inféodés de haut en bas de l’échelle sociale. Afin de survivre ou d’échapper à leur condition, ces derniers acceptent de se faire hommes de main Hitokiri (coupeurs d’hommes), exécuteurs des basses-œuvres, sous l’apparence faussement chevaleresques de samouraïs d’occasion. Ainsi, Takeshi Henpai (génial et terrifiant Tatsuya Nakadai), chef de clan « loyaliste » qui défend la cause impériale engage Izo, ronin crève la faim, qui deviendra rapidement le plus renommé de ces tueurs. Henpai exploite avec un cynisme sans scrupule la naïveté du pauvre hère qu’il métamorphose en fauve sanguinaire. Convaincu d’accéder à la dignité de samouraï de par sa sinistre réputation, il fait de sa bravoure meurtrière l’unique valeur positive, qu’il pousse jusqu’au dépassement de soi qu’il veut héroïque. Gosha étudie dans Hitokiri le magnifique paradoxe de la pureté de l’assassin. Malgré sa sauvagerie, Izo n’en demeure pas moins aussi naïf qu’un enfant et d’autant plus vulnérable. Aussi par cette imprécation lancée à chacune des mises à mort, « bras du châtiment », il proclame à son insu sa qualité d’instrument, de marionnette. Izo ne fait que répéter de manière mimétique les paroles de son maître sans en saisir la teneur et toutes ses implications morales et religieuses du « châtiment », ni même la vraie valeur d’une « punition » qui tôt ou tard sera la sienne. Cette notion de « châtiment » revêt une valeur hautement symbolique chez Gosha quand le fil du sabre finira toujours par se retourner contre les protagonistes qui le manient. Car la prise de conscience du Mal qui naît en soi devient en quelque sorte une « civilisation » du moi, un éveil sémantique, une lecture du sens d’un « mot » qui rimera avec sa propre « mort ». Comme il ne cessera de le démontrer durant son œuvre Gosha s’impose avec Hitokiri comme l’un des grands cinéastes du destin. Hitokiri va bien au-delà du genre et touche au métaphysique : « tuer » n’implique aucune culpabilité chez Izo qui ne fait qu’obéir aux ordres, accomplir une mission. Prendre la vie d’autrui n’est qu’un simple métier, une technique dont il est légitime de se glorifier. L’itinéraire du paysan devenu tueur illustre cette recherche de la survie, puis de l’ambition, et de la reconnaissance sociale par le seul moyen du meurtre. L’aristocrate raffiné se dédouane de ses actes puisqu’en les déléguant, il ne les commet pas : le maître impassible donne ses ordres à l’exécuteur en peignant ses estampes ; le notable manie le pinceau et étale la peinture, le pauvre brandit le sabre et verse le sang. Comme Kobayashi, Gosha s’empare du chambara à des fins sociales et politiques, mais la révolte contre l’imposture part ici de la base, de l’humble en qui naîtra progressivement l’insoumission.
Henpai exploite la nature frustre de celui dont il fait son homme de confiance tant qu’il en assure le contrôle, mais témoigne, par la bassesse de la tâche qu’il lui a assignée du mépris qu’il lui porte. C’est une vision on ne peut plus pessimiste que cette intelligence mise au service d’une corruption de la pureté, une sorte d’éducation au Mal, telle qu’on pourrait la percevoir actuellement chez les « enfants-soldats » dévoyés par des fous de guerre.

L’amoralité de l’acte est confortée par celle de l’époque elle-même : la célébrité grandit avec le pouvoir meurtrier et la terreur qu’il inspire, dans un monde où les « coupeurs d’homme » et leur palmarès deviennent les nouvelles inspirations héroïques, les légendes ne s’écrivant plus que dans le sang. La renommée croissante d’Izo que la rumeur populaire reconnaît comme le plus grand tueur de la région le conforte dans son idée du « bien », dans l’orgueil de sa bravoure et de son savoir faire, dans la fierté d’être ce qu’il est.
Au delà de la violente réflexion sur le sens d’une Histoire et des petites gens manipulés comme des pions qu’on fait avancer pour mieux les écraser, Hitokiri constitue une magnifique interrogation sur le Bien et le Mal, qui répondrait presque de manière nihiliste aux mythes rousseauistes du bon sauvage. Izo est en quelque sorte l’animal à apprivoiser, l’être primitif à éduquer : la rencontre avec les maîtres de la culture dominante sonne comme la perversion, la corruption, l’éveil au Mal, sous les traits d’une élégance à laquelle on ne peut faire qu’aveuglément confiance, élégance du verbe, de l’habit, de l’apparence, comme la prestance du Diable lui-même. Cette notion de « bras du châtiment » se confond avec celle de service de bien public ; le modèle à suivre est un trompe l’œil. Izo est le chien de son maître, son esclave docile, un pantin, qui se soumet au mal (et devient le mal) sans le savoir. Il ne prendra conscience de sa qualité d’être singulier au sein de la collectivité que par l’expérience de l’altérité, d’autant plus qu’elle s’incarne dans une représentante du sexe faible : la prostituée qui ne dispose pas de la somme nécessaire pour racheter sa condition, personnage opprimé et avili autant par son statut de femme que par sa place infamante parmi les hommes. « On ne peut échapper à son sort » déclare Izo qui sait dès lors qu’il aurait du rester vagabond et que seule la mort libère du joug du Mal.

Morbide jusqu’à l’étouffement, Hitokiri baigne dans un climat de complots et d’assassinats d’autant plus shakespearien qu’il se fond magnifiquement à la tragédie individuelle. Shintaro Katsu, le célèbre Zatoichi, y trouve à travers Izo un rôle à contre emploi et d’une richesse incroyable.
C’est à une démythification de l’éthique samourai que nous convie Gosha dans un monde en pleine mutation. Comme le dit l’un des protagonistes, « le monde est en train de changer », lorsque chacun s’acharne à vouloir le voir changer à sa manière les uns pour poursuivre vers l’avancée amorcée, les autres par le souhait du retour des anciennes valeurs et de l’empereur. Dans Hitokiri , le souffle épique se fait halètement et la barbarie l’emporte dans ce combat ultime et funèbre des samouraïs au terme d’une époque révolue. A ce titre, la violence graphique inouïe des combats de sabre sabre, d'où jaillissent des geysers de sang, de mêlées sauvages en guet-apens dans le dédale de ruelles ténébreuses, génère une sensation de fin d’un monde, au sein d'un paysage poisseux et apocalyptique. Il ne faut absolument pas passer à côté de chef d’œuvre absolu qu’est Hitokiri, requiem rougeoyant et fiévreux.

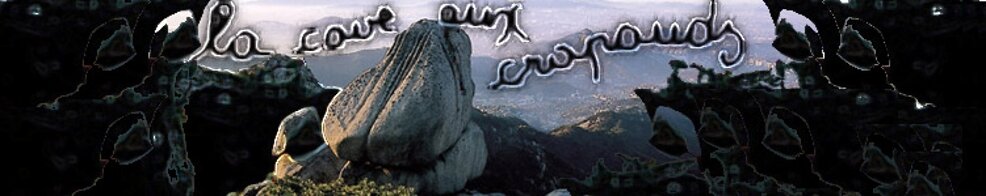


/http%3A%2F%2Fculturopoing.com%2Fimg%2Fimage%2Folivier%2F7%2BEPEES%2BPOUR%2BLE%2BROI.jpg)
/http%3A%2F%2Fculturopoing.com%2Fimg%2Fimage%2Folivier%2Fojingogo.jpg)
/http%3A%2F%2Fculturopoing.com%2Fimg%2Fimage%2Folivier%2Fmartino-I.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)